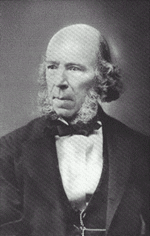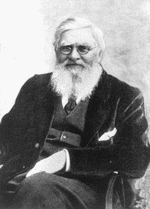|
|

|
|

♯
Ostéopathie - Les philosophes
Bienvenue chez les philosophes !
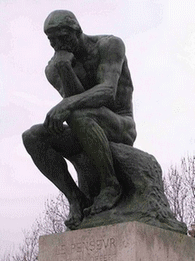 Philosophie , voilà le mot lâché... Il fait peur, il rebute.
Il nous rappelle de difficiles moments de notre époque d'étudiant, où nos professeurs tentaient avec bien des difficultés de nous intéresser au sujet...
Philosophie , voilà le mot lâché... Il fait peur, il rebute.
Il nous rappelle de difficiles moments de notre époque d'étudiant, où nos professeurs tentaient avec bien des difficultés de nous intéresser au sujet...
Ces périodes ont laissé des souvenirs suffisamment désagréables pour que nous en détournions aujourd'hui.
En fait, tout dépend de la manière dont on envisage le terme.
Quand nous pensons philosophie, nous assimilons immédiatement ce terme
au contenu des cours de philo de terminale, de grande valeur, peut-être,
mais présentés de manière tellement rébarbative, si peu en prise avec
les préoccupations du monde que nous vivons que nous nous en sommes
détournés, faute d'en percevoir l’utilité pratique. À l’évidence,
l’Éducation Nationale n’a pas encore remarqué que les préoccupations
d’un adolescent d’aujourd’hui sont fort éloignées des pensées des
philosophes, même les plus grands, des siècles passés et qu’à 17 ans, on
veut que ça bouge, on veut du concret !
Pour un américain en général, et pour Still en
particulier, le terme de « philosophie » prend une toute autre acception
: il s’agit d’une véritable manière d’envisager la vie, concrète
et surtout pragmatique
. L’efficacité s’impose. Les conclusions sont tirées de l’observation du
vivant, par opposition à une réponse spéculative à un questionnement théorique comme est la philosophie antique grecque à laquelle nous sommes habitués.
Retenez cette manière d'envisager la philosophie, parce
que nombre d'ostéopathes américains (Still, Sutherland, Becker, Frymann,
pour n'en citer que quelques uns), l'utilisent dans ce sens.
Herbert Spencer
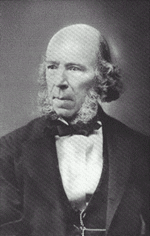 (1820-1903) Ingénieur,
philosophe anglais, fondateur de la philosophie évolutionniste. Il
tente d’élargir le concept évolutionniste développé par Darwin au
niveau de la biologie, à tous les domaines des activités humaines,
notamment la psychologie, la sociologie, l’éthique, etc.
(1820-1903) Ingénieur,
philosophe anglais, fondateur de la philosophie évolutionniste. Il
tente d’élargir le concept évolutionniste développé par Darwin au
niveau de la biologie, à tous les domaines des activités humaines,
notamment la psychologie, la sociologie, l’éthique, etc.
Tout en affirmant le caractère inconnaissable de la nature intime de
l’univers, il tente de donner une explication globale de l’évolution
des êtres à partir des lois ordinaires de la mécanique. Selon Spencer,
le monde se transforme et évolue de l’inorganique vers le biologique,
le psychologique et le social : à chacun de ces stades se vérifie la
loi de complexité croissante, par l’adaptation de plus en plus précise
des fonctions aux conditions changeantes du milieu, par l’intégration
toujours plus grande des parties au tout et par la diversification des
relations sociales.
Grâce à Herbert Spencer, la pensée évolutionniste va, de biologique,
devenir philosophique. Argumentant à partir du modèle de l'organisme,
Spencer tente d'appliquer l'idée évolutionniste à tous les domaines de
l'activité humaine, de décrire et de prescrire l'évolution sociale
comme une dépendance simple et directe de l'évolution biologique ;
extrapolation par trop simpliste, qui lui fait commettre de nombreuses
erreurs et fautes de logique.
Pourtant, dès les années 1860, le système de l’évolution de Spencer se répand et devient rapidement «
la bible séculière du développement occidental » . (Tort, 1996,
4) La pensée de Spencer s’impose aux États-Unis – où il est bien plus
populaire que Darwin –, dans toute l’Europe occidentale, même en
Russie et au Japon. Ses thèses sont universellement diffusées dans les
enseignements universitaires.
Le succès des théories de Spencer aux États-Unis tient sans doute à
plusieurs raisons. Elles s’adressent tout d’abord à des gens au bagage
philosophique peu étendu, ne disposant donc pas des outils et méthodes
qui leur permettraient d'en discerner les failles. De plus, sa
philosophie se fonde sur un principe simple, étendu à toutes les
manifestations du vivant, ce qui la rend séduisante et relativement
accessible. Enfin, l'extrapolation du concept évolutionniste au
domaine social conforte la libre entreprise et la loi du plus fort,
étayant ainsi l’argumentaire théorique des partisans du libéralisme
issu de la révolution industrielle et allant dans le sens de l’esprit
pionnier, permettant de justifier facilement certains agissements
comme l’extermination ou la déportation des peuplades amérindiennes ou
l’expansionnisme effréné dans les domaines industriel et économique.
Ses conclusions, appliquées aux domaines économique et politique vont,
enfin, dans le sens du « laisser-faire » le plus conservateur servant
bien des intérêts, et notamment ceux des nantis, d'où, sans doute, son
succès.
Avec Spencer, l'évolution se trouve dotée d'un sens fixé dès l'origine
: « l'univers progresse selon une loi de développement qui
assigne à chaque réalité une direction prédéterminée selon un ordre
de perfection croissant. La société humaine apparaît ainsi comme la
forme la plus haute de la vie et la société industrielle la forme la
plus avancée de l''organisme' social. Miracle ! c'est le cas de le
dire : Spencer prêche pour le 'laisser-faire' et démontre
scientifiquement qu'il en résultera, au bout du compte, une cohésion
plus forte de la société, une solidarité mieux assurée, parce que
rationnelle, de ses parties – en l'occurrence les classes sociales.
Il offre au capitalisme sauvage sa première grande théodicée. »
(Lecourt, 1992, 76-77)
Still et Spencer
Les éléments de biologie et de physiologie développés par Spencer
ont particulièrement intéressé et inspiré Still : « Still dira
plus tard que Herbert Spencer était son philosophe préféré et Alfred
Russel Wallace son biologiste favori, les deux étant des leaders du
mouvement évolutionniste. » (Trowbridge, 1991, 157). Ainsi,
l’ostéopathie doit à Spencer une structure philosophique, un modèle,
ou plus exactement un méta-modèle, c’est-à-dire un large cadre
conceptuel au sein duquel Still a pu élaborer un concept philosophique
cohérent, pouvant servir de fondement à son savoir-faire
thérapeutique.
« De l’approche holistique aux mécanismes de la physiologie, à
l’électricité et au magnétisme, la philosophie de Still est
imprégnée d’allusions à la philosophie spencérienne, mettant
l’accent sur les thèmes chers à Spencer que sont la causalité
naturelle, ou cause et effet, la dépendance mutuelle des parties,
structure et fonction, les effets de l’utilisation et de la
désuétude, le concept de matière, mouvement et force aussi bien que
le terme ‘Inconnaissable’, se référant à Dieu. » (Trowbridge,
1999, 227).
Si nous adoptons une vision hiérarchique, la démarche de Spencer est
de nature systémique et peut se voir comme cherchant à englober au
sein d'un modèle général, des modèles particuliers. C’est donc chez
Spencer que Still a vu conceptualisés les grands canons de la
philosophie ostéopathique :
- L’unité de tout système vivant : chaque partie vit pour et par
l’ensemble.
- L’étroite relation de la structure et de la fonction.
- Le mouvement (changement) comme manifestation première de la vie.
- La nécessité de la libre circulation des fluides au sein d’un
système vivant.
- La capacité du corps à produire les substances nécessaires à son
fonctionnement.
- La faculté d’un organisme vivant à s’auto réguler et à surmonter la
maladie.
- Les lois de cause à effet.
- L’inconnaissable.
Bibliographie
Lecourt, Dominique , 1992. L'Amérique entre
la Bible et Darwin . Presses Universitaires de France, Paris, ,
ISBN : 2-13-048905-2.
Spencer, Herbert , 1885. Premiers Principes
. Félix Alkan, Paris.
Spencer, Herbert , 1877. Principes de biologie
. Germer Baillières, Paris.
Tort, Patrick, 1996. Spencer et l'évolutionnisme philosophique . PUF Que sais-je ?, Paris, ISBN : 2-13-048034-9.
Trowbridge, Carol , 1999. La Naissance de
l'ostéopathie . Sully, Vannes, 292 p., ISBN : 2-911074-16-5.
Martine Rainville : L’influence de l’évolutionnisme
philosophique dans l’élaboration des principes ostéopathiques par
Still Mémoire de fin d'étude ostéopathique présenté devant un
jury international au collège de Montréal (Canada) en juin 2010.
Alfred Russell Wallace
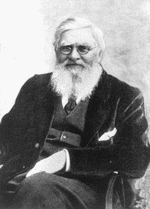 (1823-1913) Naturaliste, géographe,
explorateur, anthropologue et biologiste britannique, co-découvreur,
avec Charles Darwin, de la théorie de l'évolution par la sélection
naturelle ( Contributions to the Theory of Natural Selection
– 1870).
(1823-1913) Naturaliste, géographe,
explorateur, anthropologue et biologiste britannique, co-découvreur,
avec Charles Darwin, de la théorie de l'évolution par la sélection
naturelle ( Contributions to the Theory of Natural Selection
– 1870).
Wallace fut également l'un des principaux penseurs évolutionnistes du
XIXe siècle, contribuant au développement et à l’expansion de la
théorie de l'évolution. Il est un des pères oubliés de la biologie
moderne et l'un des premiers grands scientifiques à s'être inquiété
des conséquences de l'activité humaine sur l'environnement, ce qui le
fait considérer comme le « père de la biogéographie. »
Alfred Russel Wallace est né dans le village de Usk (Royaume-Uni) en
1823. Son père meurt quand il est encore très jeune et il est éduqué
par son frère William En 1843, il est désigné comme professeur au
collège de Leicester où il découvre la botanique. Deux ans plus tard,
il monte une expédition qui explore l’Amérique du Sud, l’Amazone et le
Rio Negro. Au retour, le bateau de Wallace fait naufrage et les
échantillons collectés sont perdus. Heureusement, les passagers s’en
sortent sans mal. Dans les douze mois qui suivent, il quitte
l’Angleterre une nouvelle fois à destination de Singapour. Ce voyage
qui durera huit ans le conduit à la formulation de sa théorie de la
sélection naturelle (parallèlement à Darwin et sans connaître ses
travaux) et fait de lui le père de la biogéographie.
La biogéographie
La biogéographie se définit comme étant l'étude et la compréhension
de la répartition des organismes vivants à la lumière des facteurs et
processus présents et passés. Pendant longtemps, la biogéographie est
restée confinée à la description de la répartition des flores et des
faunes, à la délimitation de vastes régions où la biodiversité est
plus homogène et à l'étude des mécanismes de dispersion et de
colonisation à l'échelle des continents. Elle s'opposait clairement à
l'écologie traditionnelle, science des relations, qui s'attachait à
comprendre les mécanismes et le fonctionnement d'entités biologiques
beaucoup mieux définies comme les populations ou les assemblages
d'espèces.
Depuis le début des années 1970, la biogéographie a largement évolué pour s'intéresser à d'autres objectifs, l'ouvrant vers l'écologie et
l'étude de l'évolution, en éclatant les échelles spatiales et
temporelles traditionnelles. En effet, tous les mécanismes dit «
écologiques » comme l'immigration, l'extinction, la colonisation, la
compétition... sont directement liés à la structure géographique et
sont responsables de la répartition géographique des êtres vivants.
Ainsi, les structures et les phénomènes observés à une échelle
géographique donnée sont indissociables des structures et mécanismes
mis en oeuvre aux échelles géographiques plus grandes. Cette nouvelle
approche de la biogéographie implique que la répartition des êtres
vivants est non seulement fonction des facteurs historiques, mais
également de facteurs écologiques et biologiques.
D'autres domaines d'intérêt
Vivement intéressé par la phrénologie, Wallace expérimenta très tôt
l'hypnose, alors connue sous la forme du mesmérisme. Dès 1865, il
s'intéressa au spiritualisme. Après avoir examiné les écrits sur ce
sujet et tenté d'évaluer les phénomènes dont il avait été le témoin
pendant des séances, il en vint à accepter que la croyance
correspondait à une réalité naturelle. Il demeura, tout au long de sa
vie, convaincu que malgré le nombre d'accusations de fraudes et de
preuves de supercherie apportées par les sceptiques, au moins quelques
séances étaient authentiques. Sa défense du spiritualisme et sa
croyance en une origine immatérielle pour les plus hautes facultés
mentales de l'être humain mit à mal ses relations avec le monde
scientifique, tout spécialement avec les précurseurs de
l'évolutionnisme.
Oeuvres
Review of Principles of Geology (1869)
The Geographical Distribution of Animals (1876)
Land Nationalization its Necessity and its Aims (1882)
Darwinism (1889)
Vaccination a Delusion (1898)
My Life (1905)
Elliott Coues
 (1842-1899) Elliott Coues (son nom se
prononce comme le mot cow en anglais), médecin-militaire, historien,
écrivain et ornithologue américain est né le 9 septembre 1842 à
Portsmouth dans le New Hampshire et mort le 25 décembre 1899 à
Baltimore dans le Maryland.
(1842-1899) Elliott Coues (son nom se
prononce comme le mot cow en anglais), médecin-militaire, historien,
écrivain et ornithologue américain est né le 9 septembre 1842 à
Portsmouth dans le New Hampshire et mort le 25 décembre 1899 à
Baltimore dans le Maryland.
Dès son plus jeune âge, il manifeste une grande passion pour les
animaux. En 1853, la famille Coues emménage à Washington, D.C.. Il
poursuit ses études dans un collège jésuite avant d'entrer, à 17 ans,
au Columbia College où il obtient son Bachelor of Arts en 1861, son
Master of Arts en 1862. Il publie son premier article scientifique à
19 ans ( A Monograph of the Tringae of North America )
(1861). Il bénéficie des conseils, et de l'amitié, du professeur
Spencer Fullerton Baird (1823–1887), grand ornithologue et
ichtyologiste américain.
Militaire et ornithologue
En 1862, Coues entre à l'école de médecine militaire comme cadet,
obtient son titre de médecin l'année suivante mais devient, en 1864,
assistant-chirurgien.
En 1869, on lui propose de devenir professeur de zoologie et
d'anatomie comparée à la Norwich University, école militaire privée du
Vermont, mais ses obligations de service l'empêchent d'accepter.
En 1872, il publie Key to North American Birds qui
contribue à l'essor de l'étude taxinomique des oiseaux.
Entre 1873 et 1876, Coues fait partie, comme chirurgien et
naturaliste de la Commission des frontières du nord des États-Unis
conduite par Ferdinand Vandeveer Hayden (1828-1887). Il publie, en
1874, Birds of the North West, en 1878, Birds of the Colorado Valley.
Il s'intéresse également aux mammifères comme en témoigne, en 1877, la
parution d'un important travail sur les rongeurs
nord-américains : North American Rodentia. Entre 1876 et 1880, il
devient le secrétaire et naturaliste du bureau de recherche géologique
et géographique des États-Unis. Entre 1877 et 1882, il donne des cours
d'anatomie à l'école de médecine de l'université de Columbia, devient
professeur d'anatomie entre 1882 et 1887.
En 1881, il quitte l'armée avec le rang de capitaine et se consacre
alors entièrement à la recherche scientifique et à l'écriture. Il est
l'un des trois principaux fondateurs de l'American Ornithologist's
Union, qu'il dirige de 1892 à 1895, et est responsable de l'édition de
son journal, The Auk ainsi que de plusieurs autres revues
ornithologiques. Il est l'ami et le conseiller de l'artiste Louis
Agassiz Fuertes (1874-1927).
Il est l'auteur de nombreuses publications (plus de 300), écrites par
lui seul ou en collaboration, principalement en ornithologie mais
aussi en mammalogie. Son livre Fur-Bearing Animals (1877)
est très remarqué et décrit notamment plusieurs espèces devenues rares
aujourd'hui. Mais c'est son livre Key to North American Birds
qui est considéré comme sa contribution la plus importante : il
influence une génération entière d'ornithologues aux États-Unis.
Coues et la spiritualité
Coues s'est particulièrement intéressé aux question spirituelles et
théosophiques – un côté de sa nature peu connu, même de ses proches
associés scientifiques. Entre 1885 et 1886, il assurera même la
présidence de l'Esoteric Theosophical Society of America, ainsi que
d'autres sociétés théosophiques, notamment l'American Board of Control
of the Theosophical Society of India et de la Philosophical Science
Congress du World Congress Auxillary de Chicago, en 1893.
Malgré ses nombreuses activités dans d'autres domaines, il trouva le
temps de préparer et de publier différentes brochures sur ces thèmes,
parmi lesquelles : Biogen, a Speculation on the Origin et
Nature of Life (1884), The Deamon of Darwin (1884), Buddhist
Catechism (1885), Kuthumi (1886) ; Can
Matter think ? (1886), A Women in the Case
(1887), Signs of the Times (1888). Ses liens avec la Société
théosophique furent rompus en 1889, suite à un désaccord profond avec
la fondatrice, Helena Blavastsky qu'il accusera de charlatanisme, de
falsification, de tricherie, etc. Cela lui vaudra d'être expulsé de la
société.
Il participera par la suite activement à de nombreuses encyclopédies
et supervisera l'édition de plusieurs récits de voyage dont les Journals
of Lewis and Clark (1893) et The Travels of Zebulon M.
Pike (1895).
Il décède le 25 décembre 1899 suite à une intervention chirurgicale au
John Hopkins Hospital de Baltimore dans le Maryland. Il est enterré
dans le cimetière national d'Arlington.
Liste partielle des publications
– 1861 : A monograph of the Tringeae of North America
(Philadelphie).
– 1873 : A check list of North American birds
(Naturalists' agency, Salem).
– 1874 : Field ornithology. Comprising a manual of
instruction for procuring, preparing and preserving birds, and a
check list of North American birds (Naturalists' agency,
Salem).
– 1874 : Birds of the North-west
– 1877 : Monographs on North American Rodentia ,
avec Joel Asaph Allen
– 1878 : Birds of the Colorado Valley... scientific and
popular information concerning North American ornithology
(Gov't print, Washington).
– 1878-1880 : A Bibliography of Ornithology
(incomplet).
– 1879 : A check list of North American birds
(F.W. Putnam, Salem).
– 1881-1883 : avec Winfrid Alden Stearns (1852-1909), New
England bird life: being a manual of New England ornithology
(Lee and Shepard,Boston ; C.T. Dillingham, New York).
– 1882 : The Coues check list of North American birds
(Estes and Lauriat, Boston).
– 1884 : Biogen, A Speculation on the Origin and Motive
of Life
– 1884 : The Daemon of Darwin
– 1886 : Can Matter Think ?
– 1887 : Neuro-Myology
Retour en haut de cette page
Retour à l'accueil
|
|









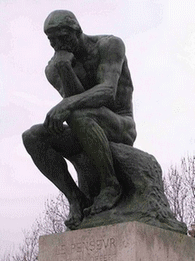 Philosophie , voilà le mot lâché... Il fait peur, il rebute.
Il nous rappelle de difficiles moments de notre époque d'étudiant, où nos professeurs tentaient avec bien des difficultés de nous intéresser au sujet...
Philosophie , voilà le mot lâché... Il fait peur, il rebute.
Il nous rappelle de difficiles moments de notre époque d'étudiant, où nos professeurs tentaient avec bien des difficultés de nous intéresser au sujet...